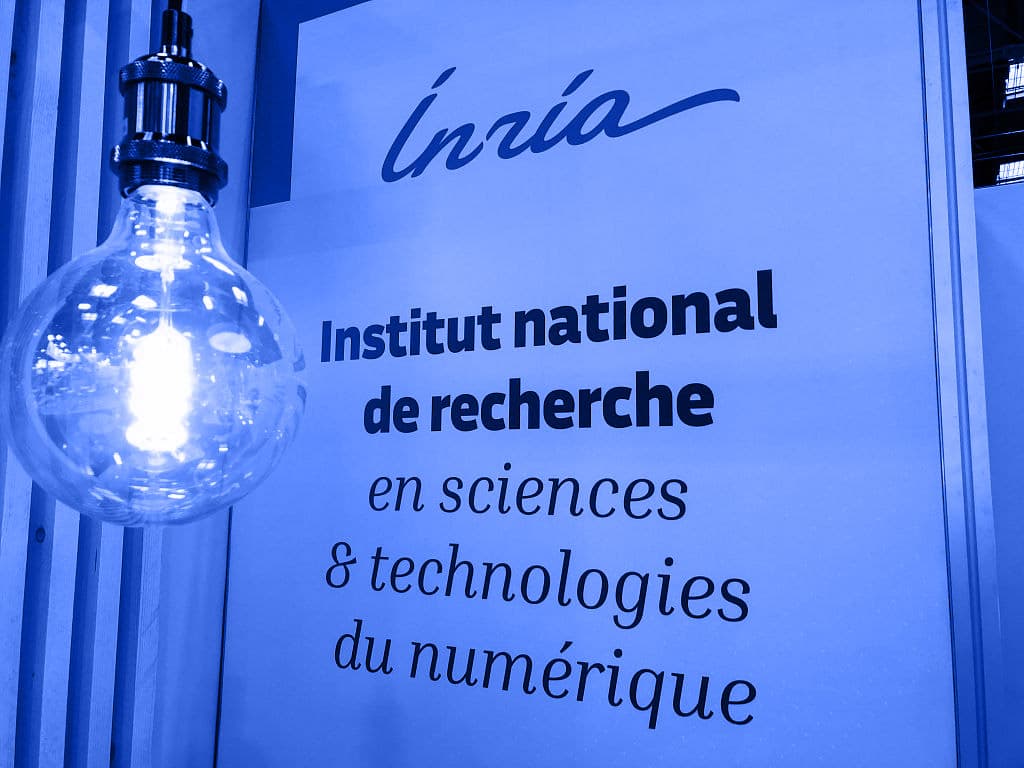Deeptech en France : sommes-nous prêts à passer à l’échelle ?
Si la France brille en matière de recherche scientifique, elle peine à produire des startups dont la croissance leur permet d’atteindre le statut de scale-up. Quels freins expliquent cette situation, et comment les lever pour permettre le passage à l’échelle de la deeptech française ? Explications à l’occasion d’une matinée…
Si la France brille en matière de recherche scientifique, elle peine à produire des startups dont la croissance leur permet d’atteindre le statut de scale-up. Quels freins expliquent cette situation, et comment les lever pour permettre le passage à l’échelle de la deeptech française ? Explications à l’occasion d’une matinée de conférences organisée par Inria lors du salon Vivatech 2025.
De l’idée à l’entreprise, du prototype à l’industrialisation, de la recherche à une technologie disruptive, aux applications concrètes et stratégiques pour le reste de l’économie. Toutes ces évolutions sont au cœur de l’activité d’Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique et en mathématiques appliquées), et plus particulièrement de son startup studio qui, sur « 700 projets identifiés ces six dernières années, en a accompagné 180, dont 60 créations de startups. Cette démarche s’inscrit dans le plan deeptech mis en place par Bpifrance, dont l’objectif est de favoriser le développement de 500 startups chaque année. Nous sommes aujourd’hui à 380, d’où cette question : comment aller plus loin et passer à l’échelle ? », se demande François Cuny, directeur général délégué à l’innovation au sein d’Inria, en introduction d’une matinée de conférences organisée mi-juin par l’Institut à l’occasion du salon Vivatech.
Des investisseurs européens trop peu nombreux et trop frileux ?
Premier élément de réponse avec Théau Peronnin, CEO d’Alice & Bob, l’un des champions français de l’informatique quantique. Après avoir rappelé que la deeptech reposait avant tout sur de la recherche scientifique, avec ses aléas et ses risques, mais aussi son potentiel disruptif, l’entrepreneur a démontré qu’un des premiers freins à lever était celui du financement : « En Europe, on applique des règles de trois bêtes et méchantes au moment d’investir. Un investisseur ne mettra jamais plus de 5 % de son enveloppe d’investissement dans une seule et unique startup, car il doit se diversifier. » Mécaniquement, une startup cherchant un investisseur capable de mettre 50 millions d’euros sur la table devra s’adresser à un fonds d’au moins 1 milliard d’euros. Problème : « Cet investisseur doté de tels moyens et qui ose financer des technologies qui ne génèrent pas encore de revenus significatifs, il n’existe pas en Europe ! »
Autre problème : un investisseur cherche avant tout un retour sur investissement, qui n’arrive qu’au moment de l’exit, soit la vente de ses parts. Mais à qui ? Si le secteur dans lequel opère la deeptech est trop stratégique, les pouvoirs publics ne risquent-ils pas de complexifier la vente de l’entreprise ? Une possibilité qui peut refroidir de nombreux acquéreurs, mais aussi, en amont, les investisseurs capables de financer le développement des startups du secteur. « C’est pour moi le problème originel », avance Théau Peronnin, qui note autant l’absence d’acteurs européens souverains capables de racheter ces startups, que de business angels habitués à prendre des risques car ils se sont eux-mêmes enrichis grâce à la deeptech et en comprennent les rouages.
De quoi expliquer, selon lui, les difficultés pour les startups deeptech à passer à l’échelle, alors que, paradoxalement, l’excellence de la recherche en France et la présence d’acteurs comme Inria, le CEA, le CNRS et Bpifrance favorisent leur naissance. D’ailleurs, le cofondateur d’Alice & Bob regrette presque un écosystème où les chercheurs qui sautent le pas sont trop protégés : la loi PACTE permet à ces derniers de garder leur place, tout en consacrant jusqu’à 50 % de leur temps à leur startup, alors que l’entrepreneuriat est une affaire de prise de risques : « Il faut se mouiller, mettre sa peau en jeu, comme disent les Anglo-Saxons ! »
Car au-delà des financements, le passage à l’échelle d’une startup est aussi une affaire de personnes. Ce dont ont témoigné Marie Paindavoine, CEO de Skyld, Jean-Michel Dalle, Managing Director de l’incubateur Agoranov, Xavier Duportet, CEO d’Eligo Bioscience et fondateur d’Hello Tomorrow, et enfin Matthias Schmitz, directeur général de The Bridge, l’incubateur allemand mis en place par le DFKI, l’équivalent d’Inria outre-Rhin. Tous intervenaient lors de la première table ronde de la matinée, animée par Sophie Pellat-Velluire, co-directrice d’Inria Startup Studio, « Et si tout commençait par les entrepreneurs scientifiques, et non par les technologies ? ». « On parle de deeptech, des aventures deeptech, des startups deeptech, mais une technologie n’est pas vivante, c’est quelque chose d’imaginé, construit, inventé par des humains, tout comme une entreprise est un organisme vivant, qui évolue en permanence portée par ses fondateurs », rappelle Sophie Pellat. « Si on ne regarde pas la chose via les fondateurs et les fondatrices, à mon avis il faut changer de métier », abonde Jean-Michel Dalle.
Encourager les scientifiques qui souhaitent devenir entrepreneurs – car c’est là que tout commence !
Premier constat : les scientifiques à l’origine des startups deeptech sont des « passionnés, qui n’ont pas peur de consacrer tout leur temps à un seul et unique sujet, malgré les doutes et les échecs », selon Matthias Schmitz. Un état d’esprit qui peut être utile à la tête d’une startup, où les hauts et les bas sont légion. « En biotech, moins de 2 % des projets éclosent d’un médicament qui fonctionne. Il faut être un peu fou et naïf, penser que l’impossible est possible et apprendre à être face à l’inconnu au quotidien », indique Xavier Duportet, pour qui le plus important n’est « pas forcément l’expérience, c’est surtout la curiosité et que les gens soient entreprenants. » Pour autant, l’adéquation entre les profils de scientifiques et d’entrepreneurs ne semble pas aller de soi pour beaucoup. Idem pour la perméabilité entre les deux environnements, alors qu’avoir des envies d’entreprendre est encore souvent un tabou dans la recherche. Il faut dire que si la passion est le moteur des deux, les modalités d’expression de cette passion diffèrent : « Le sujet du chercheur, c’est de comprendre. Comprendre la difficulté à contourner pour que ça fonctionne. Ce qui fait que la pompe à dopamine fonctionne très tôt. Malheureusement, ce n’est que 5 à 10 % du travail : il faut passer du prototype au produit, le rendre robuste, le distribuer, l’adapter au marché et le repositionner si besoin… Il faut réussir à prendre du plaisir autrement, non pas dans le fait d’avoir compris, mais dans le fait de réussir à faire comprendre aux autres l’intérêt du produit, et de leur faire adopter ce produit ! », remarque Théau Peronnin. À commencer par les investisseurs !
« C’est un vrai défi pour le passage à l’échelle », reconnaît le CEO d’Alice & Bob. Heureusement, des structures comme Inria Startup Studio existent pour accompagner les chercheurs dans ce changement de posture : « Être accompagnée par des structures issues du monde académique, comme Inria ou l’Université de Berkeley aux États-Unis, m’a permis de transformer mon discours scientifique en un discours d’entrepreneur. J’ai déjà une thèse en cryptographie, une carrière et un super produit : j’ai fait le plus dur. Apprendre à pitcher mon projet ne doit pas être rédhibitoire », explique Marie Paindavoine, qui souligne l’intérêt d’être conseillée par des mentors issus de ces structures, capables de comprendre à la fois les enjeux du chercheur et ceux de l’entrepreneur… et surtout de dépasser certains a priori : “Il faut être accompagné de personnes qui nous comprennent, qui ont cette passion pour l’entrepreneuriat, mais aussi ce bagage scientifique pour comprendre quel est l’intérêt de ce que nous faisons et nous aider, avec bienveillance, à façonner notre offre. C’est d’autant plus important quand on est une femme, et une mère qui plus est. Aux États-Unis, on m’a félicitée pour mon énergie, là où en France, on m’a demandé si j’allais m’associer à un directeur général, ou encore si mon mari était d’accord pour que j’entreprenne malgré nos enfants… »

Être capable de changer de grille de lecture, non seulement en abandonnant ses idées reçues sexistes, mais aussi en faisant évoluer sa vision de la science dans l’entreprise, est essentiel. Est-ce ce qui a permis aux États-Unis de se distinguer ces dernières décennies ? Pas uniquement. Mais, là encore, le rapport au temps long ou la médiatisation de scientifiques et d’ingénieurs devenus entrepreneurs à succès peuvent également expliquer ce qui distingue les deeptech américaines de leurs équivalentes européennes et françaises.
Des questions au cœur de la conclusion de la première table ronde de la matinée, mais aussi de la seconde. Nommée « Et si la deeptech était trop stratégique pour laisser les entrepreneurs affronter des difficultés encore plus grandes ? » et animée par Hervé Lebret, co-directeur d’Inria Startup Studio, elle réunissait un panel éclectique, composé de l’économiste Antonin Bergeaud, du député Paul Midy, de Mehdi Medjaoui, CEO d’Olympe Legal, et enfin d’Alexis Robert, General Partner de Kima Ventures.
Mieux financer la science pour empêcher la fuite des cerveaux
Eux aussi pointent du doigt la difficulté à concrétiser l’excellence académique européenne en entrepreneuriat : « Beaucoup d’ingénieurs et de chercheurs partent aux États-Unis », constate Antonin Bergeaud. Or, c’est là-bas que leurs travaux sont concrètement utilisés par des entreprises : « Tous les brevets déposés doivent donner les références académiques utilisées. On s’aperçoit qu’en Europe, on est au même niveau que les États-Unis dans la production d’idées. Mais ces idées ne sont pas citées dans des brevets français ou européens. Elles le sont dans des brevets chinois ou américains ! » Encore une fois, l’accès aux financements est évoqué : « Les levées de fonds en Europe sont trois fois inférieures à celles réalisées aux États-Unis, alors que nous avons au global pratiquement le même PIB par habitant », explique Paul Midy, qui pointe du doigt les vertus du modèle de retraite par capitalisation, qui encourage les placements sur le temps long. Soit ce dont ont besoin la recherche et les deeptech : « En France, l’épargne de long terme qui peut ressembler à de la capitalisation, c’est 200 à 300 milliards d’euros. Dans l’Union européenne, c’est 6 000 milliards, à 70 % issus de l’Europe du Nord. Aux États-Unis, la retraite par capitalisation pèse 42 000 milliards, disponibles sur 30 ou 40 ans. » De quoi financer allègrement les secteurs les plus risqués, tout en attirant les meilleurs profils outre-Atlantique. « J’appelle à ce qu’on fasse une PIC, une Politique d’Innovation Commune au moins aussi ambitieuse que la PAC, la politique agricole commune, qui pèse 30 % du budget européen, contre 10 % pour l’innovation », indique le député.
Enfin, eux aussi évoquent le nécessaire changement de grille de lecture qu’implique le financement de la deeptech, par rapport à la tech plus conventionnelle : « Les investisseurs s’attendent souvent à ce que le CEO d’une startup soit issu d’une école de commerce. Cela a fonctionné tant que la tech était ‘commodisée’, c’est-à-dire que l’entreprise fonctionnait sur un modèle SaaS, avec une planification poussée. Mais aujourd’hui, l’intelligence artificielle entraîne un retour à la science. Il faut penser hors du cadre, à l’image des CEO qui ont lancé des géants comme Sam Altman, Elon Musk ou Mark Zuckerberg, qui sont tous des computer scientists. Il faut sortir du moule », prévient Alexis Robert, constatant qu’une entreprise ayant un business model standard attire plus de capitaux qu’une entreprise sans business model, mais lancée par des chercheurs qui vont peut-être révolutionner leur secteur, comme c’est le cas d’Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix, les créateurs de Mistral AI.
Trois chercheurs qui, sans avoir fait HEC, ont été capables de maîtriser rapidement les codes de l’entrepreneuriat et du capital-risque, comme l’explique Mehdi Medjaoui : « Ils ont levé 100 millions d’euros en trois mois sur la base de quelques slides ! Tout cela car ils avaient l’ambition. » L’entrepreneur note là ce qui est peut-être également l’une des différences avec les États-Unis qui explique la difficulté à passer à l’échelle supérieure : « Je discutais avec un entrepreneur français qui développe une IA d’analyse d’image. Pour quoi faire ? Pour vérifier la conformité des pièces automobiles et diminuer les accidents. Ok ! En Californie, la même personne aurait répondu qu’elle allait sauver des dizaines de milliers de vies et des dizaines de milliards de dollars grâce à cela ! » D’où une différence fondamentale entre les deux continents : « En Europe, on est encore dans un écosystème où on fait de la technologie avec de l’argent, là où d’autres font de l’argent avec la technologie. »
La responsabilité, un pré-requis à défendre
Mais les freins qui limitent l’essor de scale-up au sein de l’écosystème deeptech européen ne se limitent pas à l’accès aux financements ou à un mauvais état d’esprit. Le sujet des normes et autres réglementations est aussi évoqué par ce deuxième panel, avec des avis divergents : « Elles ne sont pas forcément inadaptées ou illégitimes, mais quand on les empile, elles mobilisent énormément de collaborateurs et donc de temps dans les entreprises », constate Antonin Bergeaud, rejoint en partie par Paul Midy : « Si 20 à 30 % du temps des développeurs est consacré à s’occuper des sujets réglementaires, c’est étouffant. On ne devrait pas dépasser les 10 % », indique le député, reconnaissant l’existence possible d’un « trop-plein réglementaire » lié à l’empilement du DSA, du DMA ou de l’IA Act. Toutefois, il juge ces textes et normes légitimes, tant au nom de la sécurité des citoyens qu’en réponse aux enjeux environnementaux. Tout l’enjeu est d’en simplifier la compréhension par les entrepreneurs. Reste encore à ce que ces normes soient respectées par tous les acteurs de l’écosystème, rappelle Mehdi Medjaoui, selon qui, pour entraîner ses modèles, OpenAI aurait dû payer près de 1 700 milliards de dollars de droits d’auteur.

De quoi rappeler une évidence : l’innovation doit prendre place dans un cadre responsable. Responsable vis-à-vis du droit, de la société, de l’environnement, mais aussi de l’égalité des genres, alors que la difficulté à entraîner des chercheuses dans l’entrepreneuriat a été évoquée à plusieurs reprises à l’occasion de cette matinée. « Avec France 2030, nous finançons des milliers de startups », rappelle Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement de FRANCE 2030 en conclusion de cette matinée. « Elles impactent la manière dont nous allons vivre demain, alors que nous vivons une période révolutionnaire, à mettre en parallèle de l’invention de l’outil, puis de la machine. Il s’agit de l’entrée dans l’ère des robots, qu’ils soient logiciels ou matériels. Ils vont modifier en profondeur un domaine comme la médecine, avec des IA capables d’identifier une maladie mieux et plus vite qu’un médecin. » De quoi nous amener à questionner la relation de confiance que nous allons entretenir avec ces machines, tout en renforçant le besoin d’avoir un cadre, ne serait-ce qu’éthique. « Certains critiquent le RGPD, en disant que cela limite le potentiel de nos deeptechs par rapport aux États-Unis ou à Israël par exemple. Mais il faut avoir en tête que régulation ou non, c’est un schéma de société que nous définissons au travers de la deeptech. »
Startups : la fructueuse collaboration franco-allemande au cœur de Vivatech
L’intervention de Matthias Schmitz, directeur général de l’incubateur The Bridge lié au DFKI, partenaire allemand d’Inria et spécialiste de l’intelligence artificielle, s’inscrit dans la collaboration de plus en plus étroite que nouent les deux entités. Ces échanges se sont renforcés dès 2020, date de la signature d’un protocole d’accord sur l’IA, visant le rapprochement de projets existants et la naissance de nouveaux projets dans des domaines variés comme l’industrie, la santé, l’éducation ou le climat.
Par ailleurs, cette intervention, dans le cadre d’une conférence donnée lors de Vivatech, est loin d’être anodine, tant l’événement est devenu un catalyseur de ce rapprochement franco-allemand : depuis 2022, DFKI et Inria participent au stand commun mis en place par les deux pays sur le salon, tandis que l’édition 2024 a vu la signature d’un accord entre Inria Startup Studio, DFKI et Triathlon, l’incubateur de la région Sarre, pour renforcer la coopération entre ces entités, facilitant le transfert des technologies et l’émergence de startups. Cela s’est concrétisé par l’animation d’école d’été sur la partie entrepreneuriat, à la participation de porteurs de projets de l’un à des événements clefs de l’autre et à l’exploration pour la construction de co-incubations.
Une dynamique toujours à l’œuvre en 2025, comme l’indique Bruno Sportisse, le PDG d’Inria : “Cette année, nous avons élargi notre champ d’action en signant un partenariat avec la Fraunhofer Gesellschaft pour animer le dialogue franco-allemand sur l’IA dans l’industrie. Il souligne une volonté conjointe des deux pays, née de l’impulsion de l’Ambassade de France à Berlin peu avant le Sommet mondial pour l’IA de février. De tels partenariats montrent notre maturité et notre implication dans les dynamiques d’écosystème, qui ne peuvent pas se limiter au monde académique : les grands pays du numérique gagnent car ils ont des écosystèmes public/privé qui fonctionnent de manière fluide, « sans couture ». Essayer de casser les barrières, c’est notre quotidien et cela reste important. »
Date de publication : 11/07/2025
Pour poursuivre votre lecture
Envie de vous lancer ?